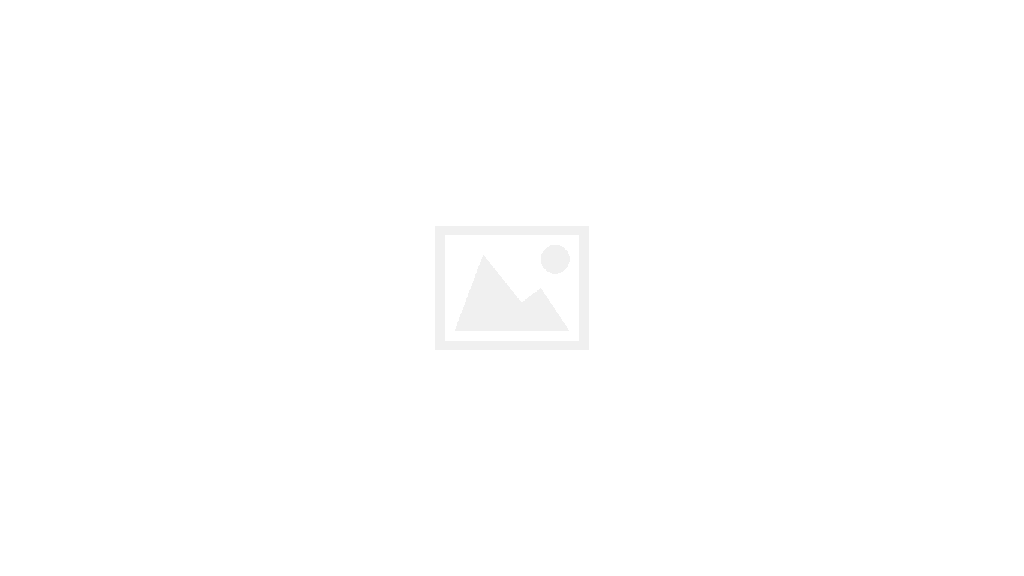![holderlin_allemagne-249x300[1]]()
Pain et vin
A Heinze
1
En cercle là autour repose la ville, silencieuse est la rue illuminée
Et ornées de flambeaux s’éloignent les voitures crissantes,
Rassasiés des joies du jour les hommes retournent au repos
Et pesant gains et pertes quelque tête pensive
Connaît la paix de la maison : vide de raisins et de fleurs
Et vide du travail des mains repose le marché affairé.
Mais des accords résonnent dans les jardins au loin ; peut-être
Est-ce un amoureux là-bas, ou un homme solitaire
Qui joue pour des amis lointains ou pour sa jeunesse ; et les sources
Toujours ruisselantes et fraîches bruissent sur leur lit parfumé.
Calmes dans la pénombre de l’air carillonnent des cloches sonores,
Et attentif aux heures un veilleur crie leur nombre.
Maintenant passe un souffle et remue la cime du bois,
Vois, et l’ombre de notre terre, la lune,
Survient, secrète, elle aussi ; la nuit, la visionnaire, arrive
Pleine d’étoiles et bien peu inquiète de nous,
Là-bas rayonne l’étonnante, l’étrangère entre les hommes,
Et sur les collines, triste et splendide, se lève.
2
Admirables sont ses bienfaits, à elle, la plus haute, et personne
Ne sait d’où ni comment ils nous viennent.
Aussi meut-elle le monde et l’âme des hommes, leur espoir,
Aucun sage même ne comprend ce qu’elle nous prépare, car ainsi
Le veut le dieu le plus grand, lui qui t’aime, et par là
T’est plus cher encore que la nuit, le jour sobre.
Mais parfois aussi un œil clair aime l’ombre,
Et cherche par plaisir, avant qu’il soit nécessaire, le sommeil,
Et l’homme intègre plonge aussi volontiers les yeux dans la nuit.
Oui, il sied de lui vouer des couronnes et des chants,
Car elle est consacrée aux déments et aux morts,
Mais elle-même se maintient, éternelle, dans l’esprit le plus libre.
Elle, pourtant, elle nous doit, pour qu’à l’heure hésitante
Et dans l’obscurité quelque chose nous soit saisissable,
Elle doit aussi nous verser l’oubli et l’ivresse sacrée
Et une parole qui afflue et qui soit, tout comme ceux qui aiment,
Sans sommeil, et la coupe plus pleine, et la vie la plus téméraire,
Et la mémoire sainte, qui nous tient éveillés dans la nuit.
3
En vain cachons-nous nos cœurs dans nos poitrines, et en vain
Cherchons-nous, maître ou disciple, à contenir la vaillance et qui donc
Nous voudrait entraver, qui voudrait nous défendre la joie ?
Un feu divin aussi nous pousse, et le jour et la nuit
A ouvrir la brèche. Ainsi, viens ! afin que nous voyions l’Ouvert
Et cherchions le bien qui est nôtre, si loin que ce soit.
Car ceci demeure : que ce soit à midi, ou même
Au profond de minuit, toujours subsiste une mesure
Commune à tous, et pourtant donnée à chacun en partage, singulière,
Par là s’en va, y parvient chacun s’il le peut.
Ainsi donc ! qu’un délire joyeux se moque des moqueurs
Quand dans la nuit sacrée il s’empare des chanteurs soudain.
Là-bas, vient, sur l’Isthme ! où bruit au large la mer
Contre le Parnasse et où la neige couronne les falaises delphiques.
Là au loin au pays de l’Olympe, là sur les hauteurs, Cithéron,
Sous les pins, parmi les grappes, là où
Monte la rumeur de Thèbes, de l’Ismène, au pays de Cadmos,
De là nous arrive et s’annonce à nouveau le dieu qui vient.
4
Grèce heureuse ! Toi, demeure pour Eux dans le Ciel,
C’est donc vrai, ce que dans notre jeunesse nous avons entendu ?
Salle de la fête ! dont le sol est la mer, dont les tables sont les montagnes,
Construite, dès avant les âges, pour un seul cérémonial.
Mais les trônes, où sont-ils ? et les temples, où sont les coupes,
Pleines de nectar, pour les dieux et la joie du chant ?
Où donc, où s’éclairent les oracles aux portées lointaines ?
Delphes sommeille, et où est la grande rumeur du destin ?
Où est-il, lui qui est brusque ? Oùéclate, partout présent et plein de bonheur,
Et tonnant, ce qui descend à nos yeux de l’air clair ?
Père Ether ! c’est l’appel qui volait de langue en langue
Mille fois crié, et nul sous la charge de vie n’était seul.
Partagé, pareil bien donne joie, échangé avec l’étranger
Il devient une acclamation, et s’accroît la force dormeuse de ce nom :
Père ! Toi, le clair ! et résonne, aussi loin qu’il porte, l’antique
Signe, hérité des aïeux, qui touche au loin et qui crée.
Ainsi reviennent Ceux du Ciel, par qui tremble la profondeur, er descend
Hors des ombres parmi les hommes leur jour.
5
Inaperçus d’abord, ils arrivent, et contre eux,
Se débattent les enfants, trop clair survient, trop brillant le bonheur
Et plein de crainte est l’homme, à peine un demi-dieu saurait dire
Quels sont les noms de ceux qui chargés de dons se rapprochent.
Mais le courage qu’ils lui donnent est grand ; et lui remplissent le cœur
Ces joies qu’ils apportent, à peine sait-il user de ce bien,
Il crée, il prodigue, et presque sacré est devenu pour lui le profane
Que sa main, généreuse follement, touche et conjure.
Ils le tolèrent, Eux dans le Ciel, autant qu’il se peut ; puis vraiment
Eux-mêmes viennent, et les hommes s’accoutument au bonheur
Et au jour et à voir ceux qui sont dévoilés, leur visage,
A ceux qui dès longtemps comme l’Un et le Tout sont nommés,
Dont la vue, librement, en silence profond, remplit et rassasie le cœur
Et d’emblée, à elle seule, contente tout désir.
Ainsi est l’homme : quand là est le bien, et que pour lui s’inquiète et se charge de dons
Un dieu même, il ne peut le savoir ni le voir.
Pour la souffrance, c’est d’abord ce qu’il doit, et alors il monte qui lui est le plus cher,
Alors, alors doivent les paroles, comme des fleurs, se lever.
6
Alors il se propose gravement d’honorer les dieux bienheureux,
En effet et en vérité doivent toutes choses proclamer leur louange.
Rien ne doit voir la lumière, qui ne plaise à Ceux d’En Haut,
Devant l’Ether n’ont droit de paraître d’inutiles tâtonnements.
Là autour, en leur présence dans le Ciel, pour s’en rendre dignes
Les peuples se disposent en ordonnances souveraines,
Entrelacés, et bâtissent des temples beaux et des villes
Fermes et nobles, qui se dressent au-dessus des bords –
Mais où sont-elles ? Où fleurissent-elles, les biens connues, les couronnes de la fête ?
Thèbes se flétrit, et Athènes ; les armes ont cessé de retentir
A Olympie, et les chars dorés dans le jeu du combat,
Et on ne couronne plus les navires à Corinthe ?
Pourquoi se taisent aussi les théâtres anciens et sacrés ?
Pourquoi la joie des danses rituelles n’est-elle plus ?
Pourquoi un dieu, comme alors, ne marque-t-il plus l’homme au front,
Ne met-il plus comme alors son empreinte sur celui qu’il frappe ?
Ou bien lui-même est venu et a pris forme de l’homme,
Et consolateur, accomplit et ferma la fête du ciel.
7
Mais, ami ! nous venons trop tard. Il est vrai, les dieux vivent
Mais au-dessus de nos têtes, là-haut, dans un autre monde.
Là ils oeuvrent sans cesse, et semblent bien peu attentifs
A notre vie, tant Eux dans le Ciel nous ménagent.
Car un vase fragile ne peut toujours les contenir,
Seulement par instant l’homme supporte la plénitude divine.
Rêver d’eux, telle est ensuite notre vie. Mais l’erreur,
Comme le sommeil, nous secourt, et ce sont détresse et nuit qui rendent forts,
Jusqu’à ce que des héros, dans les berceaux d’airain, aient grandi
Et que leur cœur soit, comme alors, semblable en force, aux Immortels.
Ils viendront, dans l’orage tonnant. Jusque-là, il me semble,
Mieux vaut dormir que d’être ainsi sans compagnon
Et d’atteindre ainsi, et ce qu’il nous faut dans l’attente faire et dire,
Je ne sais, ni pourquoi des poètes dans les temps d’indigence.
Mais ils sont, dis-tu, comme les prêtres saints du dieu de la vigne
Qui passaient dans la nuit sacrée de pays en pays.
8
En effet, quand jadis, et c’est un temps qui nous semble lointain,
Tous ils furent remontés, qui rendaient la vie favorable,
Quand le Père eut détourné des hommes son visage
Et que le deuil à bon droit eut commencé sur la terre,
Quand en dernier parut un génie silencieux, né du ciel
Et consolateur qui annonça la fin du jour et s’en fut,
Il nous laissa un signe, attestant qu’il fut là et allait
Revenir, et que le chœur du ciel laissait en retour quelques dons
Dont nous, comme alors, nous pourrions nous réjouir en hommes :
Car la joie de l’esprit, le plus grand des dons devenait
Trop grand pour les hommes, encore et toujours manquent les forts pour les joies
Les plus hautes, bien qu’un peu de gratitude survive encore, silencieuse.
Le pain est le fruit de la terre, mais la lumière le sacre,
Et c’est du dieu du tonnerre qu’est venue la joie du vin.
Ainsi nous avons mémoire d’Eux dans le Ciel, qui alors
Etaient là et qui vont revenir au temps juste,
Ainsi chantent, gravement eux aussi, les chanteurs en l’honneur du dieu de la vigne
Et pour lui, l’ancien, il n’est pas vain d’entendre leur louange.
9
Oui, ils ont raison de le dire, il réconcilie la nuit et le jour,
Sans fin, il conduit les astres du ciel par les chemins d’en bas et d’en haut,
Joyeux en tout temps, pareil au feuillage du pin toujours vert
Et qu’il aime, oùà la couronne qu’il s’est choisie dans le lierre,
Car lui demeure, et la trace des dieux enfuis
Lui-même l’apporte ici-bas aux sans dieux, au-dessous, dans l’obscur.
Ce que le chant ancien a prédit des enfants de dieu,
Vois ! nous le sommes nous-mêmes ; le fruit des Hespérides est là !
Admirable et exact ce qui s’accomplit en l’homme,
Le croira, qui l’a éprouvé ! mais tant de choses arrivent
Et rien ne se fait, car nous sommes des ombres, sans cœur jusqu’au jour
Où l’Ether notre Père, reconnu, va être à chacun et à tous.
C’est dans l’intervalle que vient, en porteur de torche, le Fils
Du Très Haut, le Syrien, parmi les ombres en bas.
Des sages bienheureux le voient ; un sourire rayonne
Des âmes prisonnières, à nouveau leurs yeux, mouillés à la lumière, scintillent.
Doucement rêve et dort le Titan dans les bras de la terre,
Même Cerbère, même lui, le jaloux, vient boire et s’endort.
Traduit de l’allemand par Jean-Pierre Faye
in, « Hölderlin » ( Les Cahiers de l’Herne)
Editions de l’Herne, 1989
Pain et vin
A Heinse
I
La ville alentour repose ; la rue éclairée fait silence,
Et les voitures à grand bruit partent, adornées de flambeaux.
Repus de joies du jour, chez eux, les hommes rentrent se reposer,
Et les gains et les pertes une tête songeuse et bien contente
Les soupèse au logis : les raisins et les fleurs et les ouvrages
De la main ont quitté le marché affairé qui repose.
Mais on entend au loin dans les jardins frémir une guitare ; peut-être
Est-ce un amant qui joue ou quelque homme solitaire
Songeant à des amis lointains, à sa jeunesse ; et les fontaines
Fraîches et toujours resurgies bruissent auprès du parterre odorant.
Dans l’air assombri du soir on entend sonner des cloches,
Et des heures non oublieux un veilleur clame le nombre.
Voici qu’arrive aussi un souffle qui fait bouger les cimes du bosquet,
Regarde ! et le calque de l’ombre de notre terre, la Lune, la voici
Secrète qui s’en vient aussi ; la passionnée, la nuit s’en vient
Pleine d’étoiles et de nous peu soucieuse sans doute,
L’Etonnante là-bas resplendit, l’Etrangère parmi les hommes,
Par-dessus les sommets monte resplendissante et triste.
II
Merveilleuses sont les faveurs que dispense la Sublimissime et personne
Ne sait de quand ni ce qui d’elle nous advient.
C’est ainsi qu’elle meut l’univers et l’âme espérante des hommes,
Le Sage même n’entend rien à ce qu’elle concerte, car c’est là
Ce que veut le Dieu suprême, qui t’aime grandement, et c’est pourquoi
Le grand jour réfléchi t’est plus cher encore qu’elle ne t’est,
Mais il arrive qu’un clair regard aime lui-même l’ombre,
Et s’essaie par plaisir, avant qu’il soit besoin, au sommeil,
Ou qu’un homme fidèle aime à contempler la nuit.
Et même il convient bien de lui vouer des couronnes et des chants,
Car elle est aux errants consacrée et aux morts,
Mais perdure elle-même, existe infiniment dans l’Esprit le plus libre.
Mais elle doit aussi, pour que dans l’hésitant séjour,
Pour qu’au cœur de l’obscur il y ait pour nous du saisissable,
Nous dispenser l’oubliance et l’ivresse sacrée,
Nous dispenser le flot roulant de la parole, qui soit, tels les amants,
Sans sommeil, ainsi qu’une coupe plus pleine, une plus audacieuse vie,
Une sainte mémoire aussi, afin que dans la nuit ? nous restons en éveil.
III
De même c’est en vain que nous cachons le cœur en nos poitrines, en vain
Que, maîtres et garçons nous gardons notre courage encore, qui pourrait
En effet l’empêcher, qui nous interdire l’allégresse ?
Un feu divin nous pousse aussi, et le jour et la nuit,
A nous mettre en chemin. Viens donc ! Que nous contemplions l’Ouvert,
Et que, si loin que soit quelque chose de propre, nous le cherchions.
Une chose demeure établie ; que ce soit à midi, ou qu’on aille
Jusque dans la minuit, il existe toujours une mesure,
Commune à tous, mais à chacun est impartie dans une mesure propre,
Vers où s’en va et vient chacun, là où il peut.
C’est pourquoi ! et railler les railleurs est chose qu’aime un délire exultant
Quand dans la nuit sacrée il s’empare soudain des chanteurs.
Aussi allons, à l’isthme vient ! là-bas, dans la grande rumeur de la mer ouverte
Aux pieds du Parnasse, où la neige étincelle aux falaises delphiques.
Au pays de l’Olympe, là-bas sur les hauteurs du Cithéron,
Sous les grands pins là-bas, parmi les vignes, d’où l’on entend monter
La rumeur, en-dessous, de Thèbes et de l’Isménos, au pays de Cadmos,
D’où vient et où fait signe de revenir le Dieu de la venue.
IV
Bienheureux pays grec ! ô, demeure de tous les Célestes autant qu’ils sont,
Ainsi donc est bien vrai ce que jadis, en notre jeunesse, nous entendîmes,
Grande salle de fête ! le sol en est la mer ! et les tables, les montagnes,
Construites en vérité pour un unique usage depuis la nuit des temps !
Mais les trônes, où sont-ils ? les temples ? où sont les vases,
Où est, rempli de nectar, pour le plaisir des dieux, le chant ?
Où sont, où brillent donc les sentences à la longue et précise portée ?
Delphes somnole, où retentit la grande destinée ?
Où est-la prestissime ? Où fait-elle effraction, emplie d’omniprésent bonheur,
Et vient frapper les yeux d’un tonnerre de ciel clair ?
Père Ether ! c’était ce qu’on criait, et ce cri mille fois volait de bouche
En bouche ; aucun ne supportait son existence seul ;
Ce bien, c’est partagé, c’est échangé, avec des étrangers qu’il réjouit,
Qu’il devient allégresse, tout en dormant grandit la puissance du mot
Père ! sérénité ! et résonne tombant aussi loin que possible, antique
L’écho du Signe, hérité de parents, qui touche et qui produit.
Car c’est ainsi que les Célestes reviennent, que dans une secousse
Profonde, descend parmi les hommes, des ombres leur grand jour.
V
Ils arrivent d’abord, sans être ressentis, les enfants sont,
Tendus vers eux ; il arrive, trop clair, le bonheur trop aveuglant,
Et l’homme s’effarouche, à peine sait un demi-dieu dire en des noms
Qui ils sont, eux qui de lui s’approchent chargés de présents.
Mais le courage qu’ils donnent est grand, leurs joies lui comblent le cœur
Et à peine sait-il user du Bien,
Qu’il crée, gaspille, et presque lui paraît sacré le non-sacré
Que d’une main bénissante, excessif et généreux. il touche.
Cela autant qu’ils peuvent les célestes les tolèrent ; mais ils viennent ensuite
Eux-mêmes en vérité et les hommes s’habituent au bonheur
Et au jour et à voir les pleinement visibles, le visage,
De ceux depuis longtemps nommés comme l’Un et le Tout,
Qui profondément comblent le cœur secret de plénitude libre,
Et rendent, eux les premiers, eux seuls, toute demande satisfaite.
L’homme est ainsi ; lorsque le Bien est là, et qu’un Dieu se soucie
Lui-même de présents pour lui, il ne le voit et ne le connaît pas.
Il faut - d’abord - qu’il porte ; mais, ce qu’il a de plus cher, maintenant
Il le nomme, désormais, doivent naître des mots telles des fleurs pour cela.
VI
Et maintenant il songe, sérieusement, à honorer les dieux bienheureux,
Tout doit réellement et vraiment proclamer leur gloire.
Rien ne doit contempler la lumière, qui ne plaise pas aux très-hauts,
Le futile esquissé n’a pas, face à l’Ether, de convenance.
C’est pourquoi pour se tenir digne dans le présent des célestes
Des peuples se disposent en agencements somptueux,
Chacun prenant sa place, et construisent les beaux temples et les villes
Avec solidité et noblesse, s’élevant au-dessus des berges –
Mais où sont-ils ? Où fleurissent les biens-connus, les couronnes de la fête ?
Thèbes se fane ainsi qu’Athènes. Les armes ne bruissent-elles plus
En Olympie, ni les chars dorés du tournoi,
Et les navires à Corinthe ne s’orneront-ils plus de guirlandes jamais ?
Pourquoi se taisent-ils, eux-aussi, les antiques théâtres sacrés ?
Pourquoi la danse consacrée n’éprouve-t-elle pas la joie ?
Pourquoi comme jadis un dieu ne marque-t-il plus le front de l’homme,
N’imprime plus, comme jadis, son sceau sur celui qu’il a touché ?
Ou bien il est venu aussi lui-même et a pris humaine figure,
Et parachevant la fête céleste l’a close, consolant.
VII
Mais, mon ami ! nous arrivons trop tard. Les Dieux, il est vrai, vivent
Mais au-dessus de notre tête, là-haut, dans un monde différent.
Ils oeuvrent là infiniment, et semblent peu se soucier de savoir
Si nous vivons, tant ils nous épargnent, les célestes.
Car un récipient trop faible ne peut toujours les tenir,
C’est seulement parfois que l’homme supporte la divine plénitude.
Et la vie est après cela un rêve d’eux. Mais l’aberrance,
Aide, comme le sommeil, et l’urgence et la nuit rendent fort,
Jusqu’à ce qu’aient grandi de héros dans le berceau d’airain suffisamment,
Que les cœurs soient aux dieux, comme jadis, semblables en force,
Là-dessus ils arrivent dans un tonnerre. En attendant, je me prends,
A penser bien souvent qu’il vaut mieux dormir que d’être ainsi
Sans compagnon, d’attendre, et que faire pourtant et que dire, cela
Je ne le sais, ni pourquoi donc, en un temps de manque, des poètes ?
Mais ils sont, me dis-tu, comme les prêtres sacrés du dieu du vin,
Qui dans la nuit sacrée passaient de pays en pays.
VIII
Lorsque, en effet, il y a quelque temps, qui nous semble bien long,
Ils sont tous remontés, ceux que la vie avait rendus heureux,
Quand le Père a détourné son visage des hommes
Et qu’a très justement commencé sur la terre le deuil,
Quand, le dernier, est apparu un tranquille génie, donneur
De consolation céleste, qui annonça la fin du jour et disparut, alors
Furent en signe que jadis il avait été là et reviendrait
Laissés par le céleste chœur quelques présents,
Dont nous puissions humainement comme jadis jouir,
Car pour la joie, avec esprit, le très grand devint trop grand
Parmi les hommes, et nous en sommes encore là, il manque encore
Les forts pour les plus hautes joies, mais en silence vit quelque gratitude.
Le pain est fruit de la terre, mais il est cependant béni par la lumière,
Et c’est du Dieu tonnant que vient la joie du vin.
C’est pourquoi les goûtant nous pensons aux célestes qui jadis
Furent là et reviendront au juste temps,
C’est pourquoi chantent aussi avec sérieux le dieu du vin les chanteurs
Et le vieux ne trouve pas vainement controuvée la louange entendue.
IX
Eh oui, ils ont raison de dire qu’il concilie le jour avec la nuit,
Qu’éternellement, vers le haut, et vers le bas, il conduit l’astre du ciel,
Continuement joyeux, comme le feuillage du pin toujours viride,
Qu’il aime et la couronne qu’il s’est choisie de lierre,
Parce qu’il demeure et porte même la trace des dieux enfuis
Jusque dans la ténèbre aux sans-dieux qui séjournent en bas.
Ce que le chant des Anciens nous a d’enfants de Dieu prédit,
Vois, c’est nous qui le sommes, nous ; c’est un fruit de l’Hespérie !
Cela est accompli merveilleusement et proche comme étant déjà chez les hommes,
Le croie qui l’a éprouvé ! mais il arrive tant de choses,
Et aucune n’agit, car nous sommes sans cœur, des ombres, jusqu’à ce que
Notre père, l’Ether, reconnaisse chacun et appartienne à tous.
Mais cependant descend, brandisseur du flambeau, le fils
Du Très Haut, le Syrien, parmi les ombres.
Des sages bienheureux voient cela ; un sourire resplendit depuis l’âme
Prisonnière, à la lumière leur œil se dégèle encore et brille.
Dans les bras de la terre il rêve plus suavement et dort, le Titan,
Et même l’envieux, même Cerbère, boit et dort.
Traduit de l’allemand par Jean-Pierre Lefebvre
In, « Anthologie bilingue de la poésie allemande »
Editions Gallimard (La Pléiade), 1995
Du même auteur :
« Je connais quelque part un château-fort… » / « Das alte Schloss zu untergraben … » (14//02/2015)
Ainsi Ménon pleurait Diotima /Menons Klagen um diotima (14/02/2016)
Le Pays / Die Heimat (06/02/2017)
Chant du destin d’Hypérion / Hyperions Schickalslied (06/02/2018)
Fantaisie du soir / Abendphantasie (06/02/2019)
En bleu adorable / In lieblicher Bläue (06/02/2020)
« Comme, lorsqu’au jour de fête... » / « Wie wenn am Feiertage... » (06/02/21)
Fête de la paix / Friedensfeier (01/08/2021)
La moitié de la vie / Hälfte des Lebens (06/02/2022)
Brod und Wein
An Heinze
1
Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,
Und, mit Fakeln geschmükt, rauschen die Wagen hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,
Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,
Und von Werken der Hand ruht der geschäfftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vieleicht, daß
Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen
Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Gloken,
Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jezt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,
Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond
Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt,
Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen
Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.
II
Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand
Weiß von wannen und was einem geschiehet von ihr.
So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen,
Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so
Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum
Ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene Tag.
Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten
Und versuchet zu Lust, eh′ es die Noth ist, den Schlaf,
Oder es blikt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin,
Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu weihn und Gesang,
Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Todten,
Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist.
Aber sie muß uns auch,daß in der zaudernden Weile,
Daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei,
Uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gönnen,
Gönnen das strömende Wort, das, wie die Liebenden, sei,
Schlummerlos und vollern Pokal und kühneres Leben,
Heilig Gedächtniß auch, wachend zu bleiben bei Nacht.
III
Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur
Halten den Muth noch wir, Meister und Knaben, denn wer
Möcht′ es hindern und wer möcht′ uns die Freude verbieten?
Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht,
Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen,
Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.
Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es gehe
Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maas,
Allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden,
Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann.
Drum! und spotten des Spotts mag gern frohlokkender Wahnsinn,
Wenn er in heiliger Nacht plözlich die Sänger ergreift.
Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo das offene Meer rauscht
Am Parnaß und der Schnee delphische Felsen umglänzt,
Dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Cithärons,
Unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo
Thebe drunten und Ismenos rauscht im Lande des Kadmos,
Dorther kommt und zurük deutet der kommende Gott.
IV
Seeliges Griechenland! du Haus der Himmlischen alle,
Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört?
Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und Tische die Berge,
Wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut!
Aber die Thronen, wo? die Tempel, und wo die Gefäße,
Wo mit Nectar gefüllt, Göttern zu Lust der Gesang?
Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprüche?
Delphi schlummert und wo tönet das große Geschik?
Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegenwärtigen Glüks voll
Donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein?
Vater Aether! so riefs und flog von Zunge zu Zunge
Tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein;
Ausgetheilet erfreut solch Gut und getauschet, mit Fremden,
Wirds ein Jubel, es wächst schlafend des Wortes Gewalt
Vater! heiter! und hallt, so weit es gehet, das uralt
Zeichen, von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab.
Denn so kehren die Himmlischen ein, tiefschütternd gelangt so
Aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag.
V
Unempfunden kommen sie erst, es streben entgegen
Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu blendend das Glük,
Und es scheut sie der Mensch, kaum weiß zu sagen ein Halbgott,
Wer mit Nahmen sie sind, die mit den Gaaben ihm nahn.
Aber der Muth von ihnen ist groß, es füllen das Herz ihm
Ihre Freuden und kaum weiß er zu brauchen das Gut,
Schafft, verschwendet und fast ward ihm Unheiliges heilig,
Das er mit seegnender Hand thörig und gütig berührt.
Möglichst dulden die Himmlischen diß; dann aber in Wahrheit
Kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Glüks
Und des Tags und zu schaun die Offenbaren, das Antliz
Derer, welche, schon längst Eines und Alles genannt,
Tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllet,
Und zuerst und allein alles Verlangen beglükt;
So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, und es sorget mit Gaaben
Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er es nicht.
Tragen muß er, zuvor; nun aber nennt er sein Liebstes,
Nun, nun müssen dafür Worte, wie Blumen, entstehn.
VI
Und nun denkt er zu ehren in Ernst die seeligen Götter,
Wirklich und wahrhaft muß alles verkünden ihr Lob.
Nichts darf schauen das Licht, was nicht den Hohen gefället,
Vor den Aether gebührt müßigversuchendes nicht.
Drum in der Gegenwart der Himmlischen würdig zu stehen,
Richten in herrlichen Ordnungen Völker sich auf
Untereinander und baun die schönen Tempel und Städte
Vest und edel, sie gehn über Gestaden empor -
Aber wo sind sie? wo blühn die Bekannten, die Kronen des Festes?
Thebe welkt und Athen; rauschen die Waffen nicht mehr
In Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels,
Und bekränzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths?
Warum schweigen auch sie, die alten heilgen Theater?
Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz?
Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht,
Drükt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen auf?
Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an
Und vollendet′ und schloß tröstend das himmlische Fest.
VII
Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter,
Aber über dem Haupt droben in anderer Welt.
Endlos wirken sie da und scheinens wenig zu achten,
Ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns.
Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen,
Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.
Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsaal
Hilft, wie Schlummer und stark machet die Noth und die Nacht,
Biß daß Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen,
Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind.
Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters
Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,
So zu harren und was zu thun indeß und zu sagen,
Weiß ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit?
Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester,
Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.
VIII
Nemlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie lange,
Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglükt,
Als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen,
Und das Trauern mit Recht über der Erde begann,
Als erschienen zu lezt ein stiller Genius, himmlisch
Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet′ und schwand,
Ließ zum Zeichen, daß einst er da gewesen und wieder
Käme, der himmlische Chor einige Gaaben zurük,
Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu freuen vermöchten,
Denn zur Freude, mit Geist, wurde das Größre zu groß
Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten
Freuden, aber es lebt stille noch einiger Dank.
Brod ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte geseegnet,
Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins.
Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst
Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit,
Darum singen sie auch mit Ernst die Sänger den Weingott
Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob.
IX
Ja! sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus,
Führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf,
Allzeit froh, wie das Laub der immergrünenden Fichte,
Das er liebt, und der Kranz, den er von Epheu gewählt,
Weil er bleibet und selbst die Spur der entflohenen Götter
Götterlosen hinab unter das Finstere bringt.
Was der Alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt,
Siehe! wir sind es, wir; Frucht von Hesperien ists!
Wunderbar und genau ists als an Menschen erfüllet,
Glaube, wer es geprüft! aber so vieles geschieht,
Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser
Vater Aether erkannt jeden und allen gehört.
Aber indessen kommt als Fakelschwinger des Höchsten
Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab.
Seelige Weise sehns; ein Lächeln aus der gefangnen
Seele leuchtet, dem Licht thauet ihr Auge noch auf.
Sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan,
Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.
Poème précédent en allemand :
Friedrich Nietzche : « Et si nous sommes dans les ruisseaux de la vie... » / « Und ob wir in des Lebens Bächen stehen... » (03/02/2023)
![issa35[1]](http://storage.canalblog.com/54/75/1201889/132563834.jpg)
![130841363[1]](http://storage.canalblog.com/37/79/1201889/132568149.jpg)
![holderlin_allemagne-249x300[1]](http://storage.canalblog.com/87/77/1201889/132574503.jpg)
![pdf_54c786f2-eca7-11e3-8dc9-97d26a82e382[1]](http://storage.canalblog.com/38/83/1201889/132588161.jpg)
![03[1]](http://storage.canalblog.com/47/19/1201889/132591353.jpg)
![640px-Octavio_Paz_-_1988_Malmö[1]](http://storage.canalblog.com/86/21/1201889/132594182.jpg)
![monserrat-alvarez-mapa-SHA-2-web[1]](http://storage.canalblog.com/60/23/1201889/132599078.jpg)
![biraplum[1]](http://storage.canalblog.com/72/59/1201889/132604619.gif)
![63e1d8_27540923846045ddbbb25c4dca7127f3[1]](http://storage.canalblog.com/07/39/1201889/132610147.png)
![gabriela-mistral[1]](http://storage.canalblog.com/19/60/1201889/132615005.jpg)